Philippe Camburet, président de Bio Bourgogne Pour une bio en phase avec les besoins des territoires
À l'occasion de la parution de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique en Bourgogne Franche-Comté, nous avons posé trois questions à Philippe Camburet, président de Bio Bourgogne.
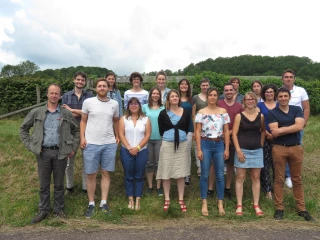
Les chiffres 2017 de l'OPAB BFC 2018 rassurent quant à la pérennité de la dynamique des conversions. Cette tendance forte doit pleinement vous satisfaire ?
Philippe Camburet : En fait, nous rattrapons notre retard… En Bourgogne l'agriculture biologique concerne désormais 100.000 hectares, ce qui correspond à 7 % de la sole totale. Certaines politiques d'incitation à la conversion ont un effet levier important, comme celle de l'Agence de l'eau . Certaines Communautés de communes aussi vont dans le sens des conversions quand elles travaillent à relocaliser les approvisionnements, notamment pour les cultures maraîchères. Ces politiques s'accompagnent aussi de formations pour les cuisiniers des collectivités et encouragent le développement de groupements d'achat. C'est un vrai défi pour Bio Bourgogne qui est missionné pour organiser ce type de relocalisation. Une nouvelle convention signée avec la Communauté de communes de Beaune prévoit ainsi l'introduction de 20 % de produits bio dans les cantines. C'est un travail de longue haleine qui demande aussi de sensibiliser les parlementaires et tous les acteurs de la restauration hors foyer. Maintenant il faut savoir que l'essentiel des conversions se fait dans des filières longues, ce qui nécessite un accompagnement spécifique et des outils adaptés. Enfin, une dynamique soutenue de conversion entraîne nécessairement une dynamique d'accompagnement tout aussi soutenue et des moyens afin que les systèmes bios conservent leur cohérence et soient économiquement rentables.
Quelle est la marge de progression de l'agriculture biologique en France et comment se situe-t-elle, face au défi du développement d'une bio européenne et mondiale, très présente sur les marchés, portée par les grandes surfaces qui ont rapidement investi ce créneau porteur ?
P.C. : La bio en France bénéficie encore d'une grande marge de progression, mais face à la concurrence de l'extérieur nous avons tout intérêt à jouer la carte de la différenciation par la territorialisation des productions. Il y a un gros travail à mener aussi sur la réintroduction ou le développement de certaines productions. De même, le soja a une carte importante à jouer pour un rééquilibrage protéique dans l'alimentation humaine. Maintenant, il faut aussi que les moyens techniques et la recherche suivent et accompagnent la progression de l'agriculture biologique. La priorité pour l'agriculture biologique française c'est d'abord d'arriver à satisfaire les besoins locaux. Sa logique de développement n'est pas celle des grands marchés, mais celle d'une réponse aux attentes d'une consommation locale et territoriale. D'ailleurs beaucoup de conversions s'accompagnent d'un projet de vente directe ou de commercialisation en circuit court.
Développer la bio par la territorialisation des productions, suppose d'amener les systèmes à la plus grande autonomie possible. La sécheresse persistante et l'été caniculaire, ont mis à mal les productions fourragères en bio comme en conventionnel, comment amener les exploitations à plus de résilience ?
P.C. : La bio doit être d'autant plus ancrée dans les territoires qu'elle peut être intégrée à toutes les stratégies locales qui concernent la protection de l'eau, la préservation de la biodiversité, la santé… L'autonomie alimentaire, la diversité des assolements, l'allongement des rotations sont constitutifs de la performance des systèmes bio, mais cette année la sécheresse persistante et l'été caniculaire ont mis à mal les systèmes bios comme les systèmes conventionnels. Le manque de fourrages bio a nécessité d'accompagner des demandes de dérogations permettant d'introduire dans les rations une part de fourrages non bio. Mais la production fourragère ne concerne pas que les exploitations d'élevage, les exploitations de grandes cultures bios intègrent également une large part de cultures fourragères. Ces cultures indispensables à l'équilibre agronomique des systèmes de production sont exclues du cadre assurantiel. Pour pallier ce manque à gagner évident, il serait bon d'engager une réflexion sur une forme d'ICHN végétal. Économiquement, un agriculteur biologique raisonne différemment, il ne vise pas la performance, mais il travaille sur la durée en considérant sa marge rotationnelle. Une rotation sur dix à douze cultures permet de lisser le résultat en répartissant les risques. C'est là que se situe la plus forte résilience des systèmes bio et c'est ce qu'il nous faut préserver. Dans la prochaine Pac nous espérons pouvoir défendre l'apport de la bio en termes de services environnementaux à rémunérer, mais en attendant, il faudra bien trouver une solution de remplacement à l'aide au maintien si l'on veut que la bio conserve ses spécificités, ses atouts et son attractivité.
Propos recueillis par Anne-Marie Klein
Philippe Camburet, président de Bio Bourgogne Pour une bio en phase avec les besoins des territoires
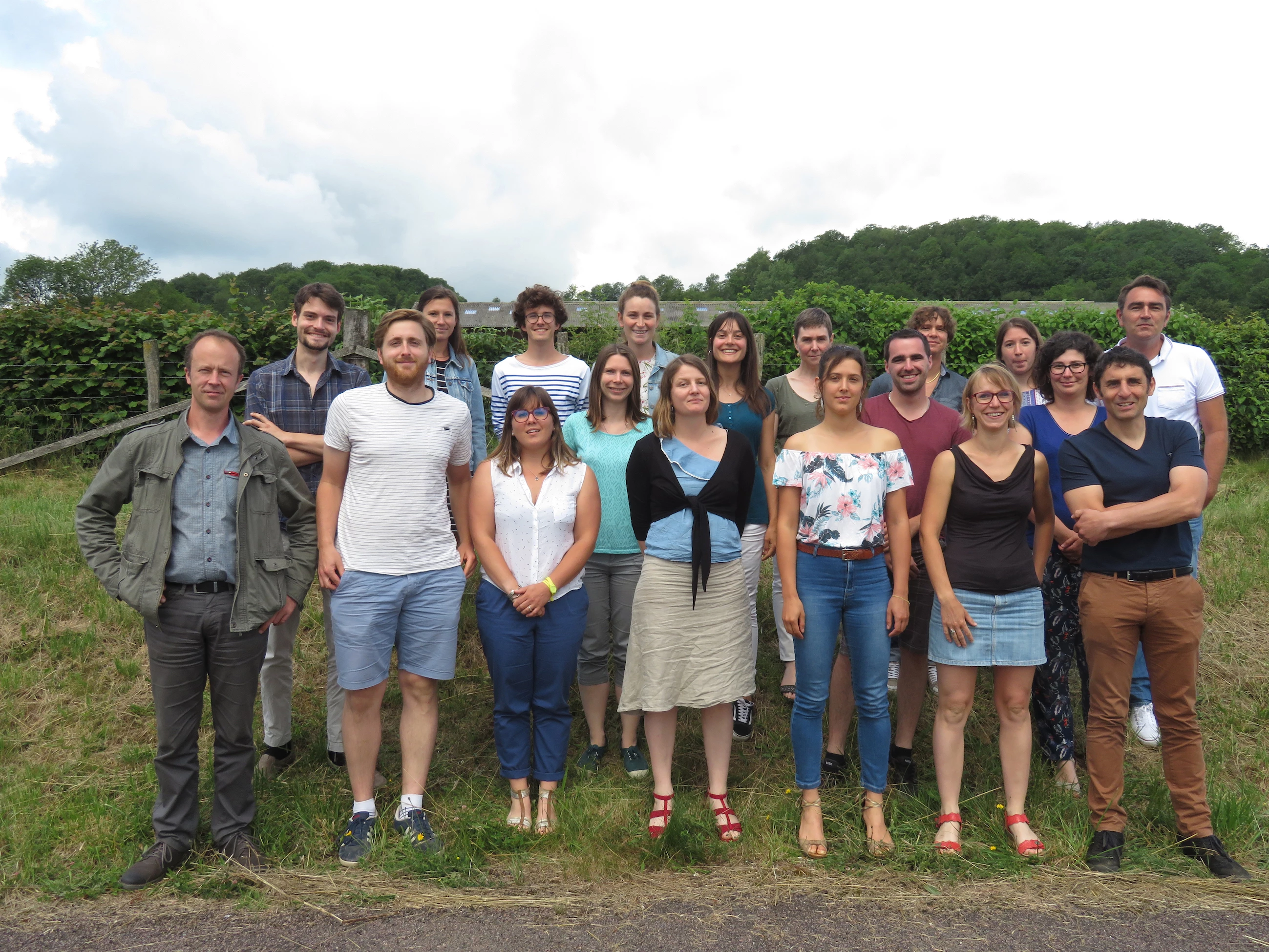
Les chiffres 2017 de l'OPAB BFC 2018 rassurent quant à la pérennité de la dynamique des conversions. Cette tendance forte doit pleinement vous satisfaire ?
Philippe Camburet : En fait, nous rattrapons notre retard… En Bourgogne l'agriculture biologique concerne désormais 100.000 hectares, ce qui correspond à 7 % de la sole totale. Certaines politiques d'incitation à la conversion ont un effet levier important, comme celle de l'Agence de l'eau . Certaines Communautés de communes aussi vont dans le sens des conversions quand elles travaillent à relocaliser les approvisionnements, notamment pour les cultures maraîchères. Ces politiques s'accompagnent aussi de formations pour les cuisiniers des collectivités et encouragent le développement de groupements d'achat. C'est un vrai défi pour Bio Bourgogne qui est missionné pour organiser ce type de relocalisation. Une nouvelle convention signée avec la Communauté de communes de Beaune prévoit ainsi l'introduction de 20 % de produits bio dans les cantines. C'est un travail de longue haleine qui demande aussi de sensibiliser les parlementaires et tous les acteurs de la restauration hors foyer. Maintenant il faut savoir que l'essentiel des conversions se fait dans des filières longues, ce qui nécessite un accompagnement spécifique et des outils adaptés. Enfin, une dynamique soutenue de conversion entraîne nécessairement une dynamique d'accompagnement tout aussi soutenue et des moyens afin que les systèmes bios conservent leur cohérence et soient économiquement rentables.
Quelle est la marge de progression de l'agriculture biologique en France et comment se situe-t-elle, face au défi du développement d'une bio européenne et mondiale, très présente sur les marchés, portée par les grandes surfaces qui ont rapidement investi ce créneau porteur ?
P.C. : La bio en France bénéficie encore d'une grande marge de progression, mais face à la concurrence de l'extérieur nous avons tout intérêt à jouer la carte de la différenciation par la territorialisation des productions. Il y a un gros travail à mener aussi sur la réintroduction ou le développement de certaines productions. De même, le soja a une carte importante à jouer pour un rééquilibrage protéique dans l'alimentation humaine. Maintenant, il faut aussi que les moyens techniques et la recherche suivent et accompagnent la progression de l'agriculture biologique. La priorité pour l'agriculture biologique française c'est d'abord d'arriver à satisfaire les besoins locaux. Sa logique de développement n'est pas celle des grands marchés, mais celle d'une réponse aux attentes d'une consommation locale et territoriale. D'ailleurs beaucoup de conversions s'accompagnent d'un projet de vente directe ou de commercialisation en circuit court.
Développer la bio par la territorialisation des productions, suppose d'amener les systèmes à la plus grande autonomie possible. La sécheresse persistante et l'été caniculaire, ont mis à mal les productions fourragères en bio comme en conventionnel, comment amener les exploitations à plus de résilience ?
P.C. : La bio doit être d'autant plus ancrée dans les territoires qu'elle peut être intégrée à toutes les stratégies locales qui concernent la protection de l'eau, la préservation de la biodiversité, la santé… L'autonomie alimentaire, la diversité des assolements, l'allongement des rotations sont constitutifs de la performance des systèmes bio, mais cette année la sécheresse persistante et l'été caniculaire ont mis à mal les systèmes bios comme les systèmes conventionnels. Le manque de fourrages bio a nécessité d'accompagner des demandes de dérogations permettant d'introduire dans les rations une part de fourrages non bio. Mais la production fourragère ne concerne pas que les exploitations d'élevage, les exploitations de grandes cultures bios intègrent également une large part de cultures fourragères. Ces cultures indispensables à l'équilibre agronomique des systèmes de production sont exclues du cadre assurantiel. Pour pallier ce manque à gagner évident, il serait bon d'engager une réflexion sur une forme d'ICHN végétal. Économiquement, un agriculteur biologique raisonne différemment, il ne vise pas la performance, mais il travaille sur la durée en considérant sa marge rotationnelle. Une rotation sur dix à douze cultures permet de lisser le résultat en répartissant les risques. C'est là que se situe la plus forte résilience des systèmes bio et c'est ce qu'il nous faut préserver. Dans la prochaine Pac nous espérons pouvoir défendre l'apport de la bio en termes de services environnementaux à rémunérer, mais en attendant, il faudra bien trouver une solution de remplacement à l'aide au maintien si l'on veut que la bio conserve ses spécificités, ses atouts et son attractivité.
Propos recueillis par Anne-Marie Klein
Philippe Camburet, président de Bio Bourgogne Pour une bio en phase avec les besoins des territoires
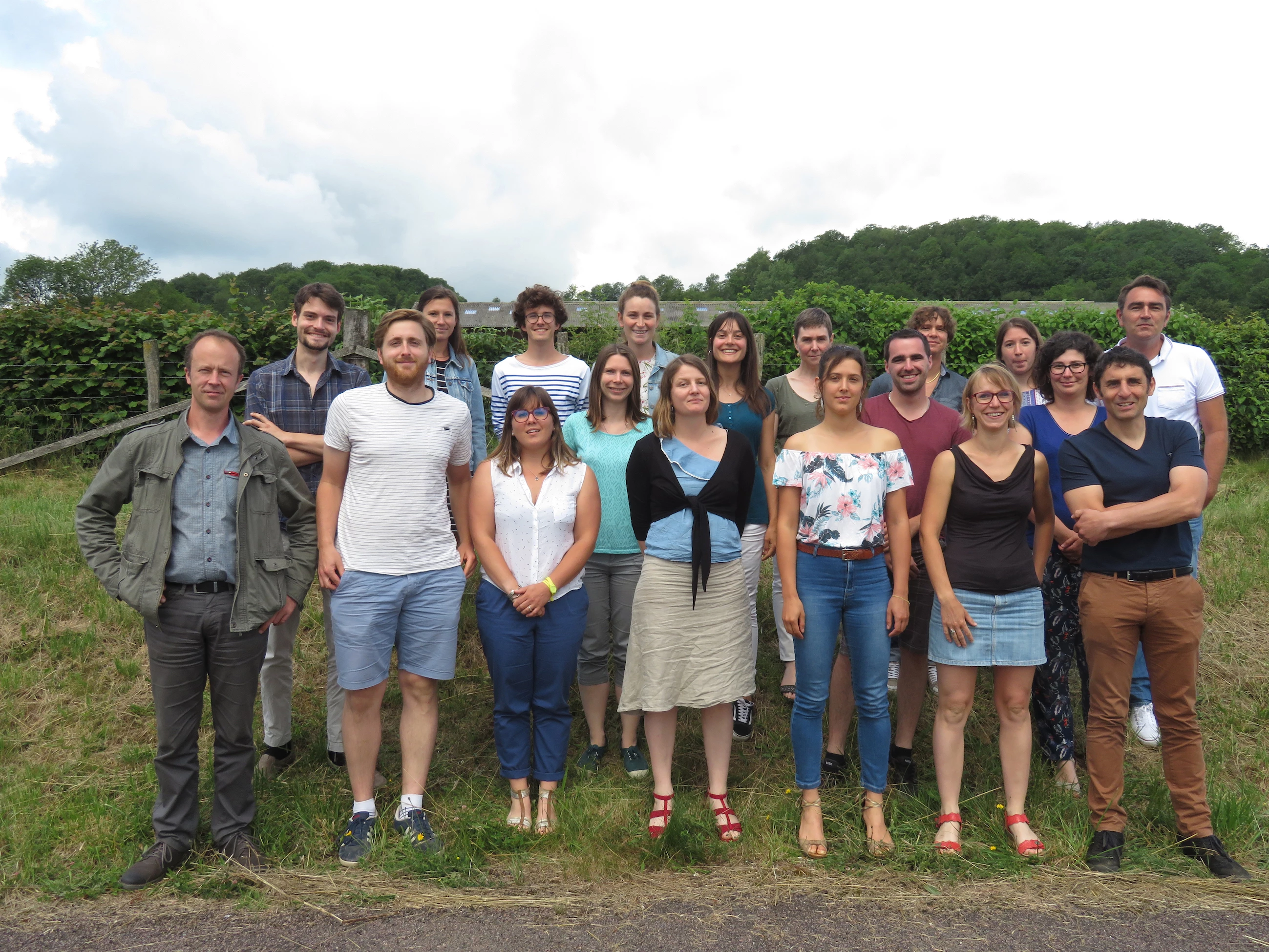
Les chiffres 2017 de l'OPAB BFC 2018 rassurent quant à la pérennité de la dynamique des conversions. Cette tendance forte doit pleinement vous satisfaire ?
Philippe Camburet : En fait, nous rattrapons notre retard… En Bourgogne l'agriculture biologique concerne désormais 100.000 hectares, ce qui correspond à 7 % de la sole totale. Certaines politiques d'incitation à la conversion ont un effet levier important, comme celle de l'Agence de l'eau . Certaines Communautés de communes aussi vont dans le sens des conversions quand elles travaillent à relocaliser les approvisionnements, notamment pour les cultures maraîchères. Ces politiques s'accompagnent aussi de formations pour les cuisiniers des collectivités et encouragent le développement de groupements d'achat. C'est un vrai défi pour Bio Bourgogne qui est missionné pour organiser ce type de relocalisation. Une nouvelle convention signée avec la Communauté de communes de Beaune prévoit ainsi l'introduction de 20 % de produits bio dans les cantines. C'est un travail de longue haleine qui demande aussi de sensibiliser les parlementaires et tous les acteurs de la restauration hors foyer. Maintenant il faut savoir que l'essentiel des conversions se fait dans des filières longues, ce qui nécessite un accompagnement spécifique et des outils adaptés. Enfin, une dynamique soutenue de conversion entraîne nécessairement une dynamique d'accompagnement tout aussi soutenue et des moyens afin que les systèmes bios conservent leur cohérence et soient économiquement rentables.
Quelle est la marge de progression de l'agriculture biologique en France et comment se situe-t-elle, face au défi du développement d'une bio européenne et mondiale, très présente sur les marchés, portée par les grandes surfaces qui ont rapidement investi ce créneau porteur ?
P.C. : La bio en France bénéficie encore d'une grande marge de progression, mais face à la concurrence de l'extérieur nous avons tout intérêt à jouer la carte de la différenciation par la territorialisation des productions. Il y a un gros travail à mener aussi sur la réintroduction ou le développement de certaines productions. De même, le soja a une carte importante à jouer pour un rééquilibrage protéique dans l'alimentation humaine. Maintenant, il faut aussi que les moyens techniques et la recherche suivent et accompagnent la progression de l'agriculture biologique. La priorité pour l'agriculture biologique française c'est d'abord d'arriver à satisfaire les besoins locaux. Sa logique de développement n'est pas celle des grands marchés, mais celle d'une réponse aux attentes d'une consommation locale et territoriale. D'ailleurs beaucoup de conversions s'accompagnent d'un projet de vente directe ou de commercialisation en circuit court.
Développer la bio par la territorialisation des productions, suppose d'amener les systèmes à la plus grande autonomie possible. La sécheresse persistante et l'été caniculaire, ont mis à mal les productions fourragères en bio comme en conventionnel, comment amener les exploitations à plus de résilience ?
P.C. : La bio doit être d'autant plus ancrée dans les territoires qu'elle peut être intégrée à toutes les stratégies locales qui concernent la protection de l'eau, la préservation de la biodiversité, la santé… L'autonomie alimentaire, la diversité des assolements, l'allongement des rotations sont constitutifs de la performance des systèmes bio, mais cette année la sécheresse persistante et l'été caniculaire ont mis à mal les systèmes bios comme les systèmes conventionnels. Le manque de fourrages bio a nécessité d'accompagner des demandes de dérogations permettant d'introduire dans les rations une part de fourrages non bio. Mais la production fourragère ne concerne pas que les exploitations d'élevage, les exploitations de grandes cultures bios intègrent également une large part de cultures fourragères. Ces cultures indispensables à l'équilibre agronomique des systèmes de production sont exclues du cadre assurantiel. Pour pallier ce manque à gagner évident, il serait bon d'engager une réflexion sur une forme d'ICHN végétal. Économiquement, un agriculteur biologique raisonne différemment, il ne vise pas la performance, mais il travaille sur la durée en considérant sa marge rotationnelle. Une rotation sur dix à douze cultures permet de lisser le résultat en répartissant les risques. C'est là que se situe la plus forte résilience des systèmes bio et c'est ce qu'il nous faut préserver. Dans la prochaine Pac nous espérons pouvoir défendre l'apport de la bio en termes de services environnementaux à rémunérer, mais en attendant, il faudra bien trouver une solution de remplacement à l'aide au maintien si l'on veut que la bio conserve ses spécificités, ses atouts et son attractivité.
Propos recueillis par Anne-Marie Klein





